Google rebat une nouvelle fois les cartes de la publicité santé avec une nouvelle mise à jour du règlement Google Ads concernant la santé et les médicaments qui entrera en vigueur le 29 octobre 2025. Décryptage.
Après plusieurs ajustements en 2025 (ouverture encadrée pour la télémédecine au Royaume-Uni et à Singapour, assouplissement sur certaines substances en vente libre) la plateforme prépare, au 29 octobre 2025, une évolution sensible autour des termes liés aux médicaments sur ordonnance. Pour les acteurs français de la santé (laboratoires, e-pharmacies autorisées, start-ups de télémédecine, éditeurs) l’enjeu est double : comprendre précisément ce que Google autorise et avec quelles certifications ; sécuriser ensuite créations, mots-clés et pages d’atterrissage pour éviter les refus d’annonces ou, pire, des suspensions de compte.
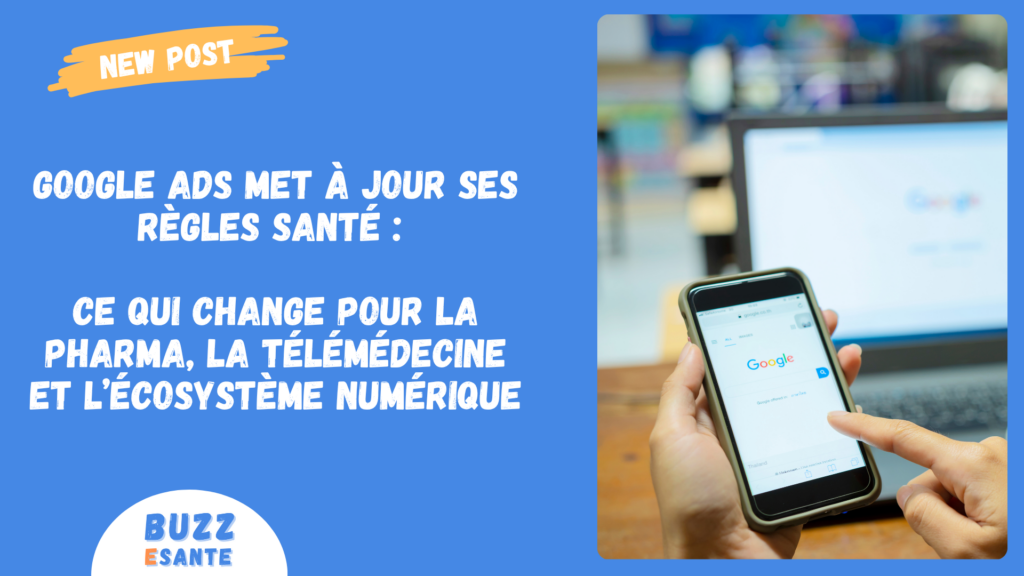
Le socle ne bouge pas : la politique « Santé et médicaments » encadre strictement la promotion des médicaments et des services associés, avec des variations par pays. En France, comme dans « la plupart des régions du monde », l’usage de termes associés à des médicaments sous ordonnance reste en principe interdit dans les annonces, les mots-clés et… les pages d’atterrissage, sauf cas spécifiques et sous certification Google « Health care » (ou dispositifs tiers comme LegitScript selon les catégories). Autrement dit : un contenu éditorial ou institutionnel qui cite un nom de spécialité peut déclencher une non-conformité si le contexte est jugé promotionnel ou si la page n’est pas correctement balisée, même sans intention de vendre.
Deux inflexions récentes sont toutefois à noter. D’abord, en juillet 2025, Google a élargi le périmètre où les opérateurs de télémédecine peuvent promouvoir des services liés à la prescription, avec un feu vert encadré au Royaume-Uni et à Singapour. Cela ne vaut pas reconnaissance globale : chaque pays garde ses conditions et ses interdictions, mais la tendance va vers une lecture plus fine des services médicaux en ligne et de la chaîne de prescription-dispensation.
Ensuite, Google prévoit au 29 octobre 2025 d’assouplir de façon ciblée l’usage de termes de médicaments : un emploi « contextuel, non promotionnel » pourra être admis dans certaines annonces, tandis que les règles sur les mots-clés et la certification resteraient inchangées. Concrètement, citer une molécule dans un message éducatif ou d’information pourrait ne plus faire tomber automatiquement l’annonce, à condition de respecter strictement le cadre (pas d’incitation, pas d’achat direct, pas de bénéfice allégué non validé, conformité pays).
Côté substances, un signal est passé plus inaperçu : en juin 2025, la catégorie « substances non approuvées » a été retouchée pour autoriser la promotion de la mélatonine hors États-Unis et Canada, sous réserve du droit local. Ce point illustre la manière dont Google ajuste, au fil de l’eau, des listes non exhaustives qui peuvent impacter des dispositifs de sommeil, nutraceutiques et parapharmacie. Les annonceurs doivent donc vérifier régulièrement les tableaux et FAQ associés.
Pourquoi ces mouvements importent-ils au-delà du « paid media » ? Parce que Google demeure l’axe majeur d’acquisition et d’information grand public. Un refus d’annonce peut ralentir une campagne de prévention ou de bon usage ; à l’inverse, un assouplissement mal compris peut exposer à des risques réglementaires. Les récents bras de fer au Royaume-Uni sur la promotion des agonistes du GLP-1 montrent le niveau de vigilance autour des POMs (Prescription-Only Medicines) et des promesses implicites dans les visuels et les mots. La frontière entre information de santé et incitation commerciale reste étroite, et les autorités (tout comme Google) regardent désormais autant les formulations que l’imagerie employée.
Pour les acteurs français, cinq implications se dégagent :
- Travailler à partir de la page « Santé et médicaments » et de ses annexes thématiques (« prescription drug services », « restricted drug terms »), en considérant la France et l’UE comme des territoires à risque élevé pour tout contenu proche du médicament sous prescription. La certification Google reste un passage obligé pour certaines catégories de services, en plus des obligations locales (statuts d’officine en ligne, respect du droit de la publicité en santé, etc.).
- Calibrer la sémantique : l’usage « contextuel non promotionnel » évoqué par Google ne vaut pas blanc-seing ; il faudra documenter le caractère éducatif, éviter les appels à l’action ambigus et contrôler rigoureusement les pages d’atterrissage, souvent causes de refus même quand l’annonce est propre.
- Anticiper les cas particuliers : addiction, reproduction, santé sexuelle ou dépistages peuvent déclencher des filtres transverses « contenus adultes » ou « services sensibles », avec des effets parfois contre-intuitifs sur des campagnes d’intérêt général
- Outiller la conformité créative : bibliothèques de messages validés, cartographie des termes interdits/à risque, versions alternatives pour les marchés anglo-saxons vs UE.
- Intégrer le temps de « troubleshooting » dans les plannings : entre demandes de revue manuelle, ajustements de mot-clé, et preuves de certification, les délais s’allongent.
En toile de fond, Google cherche un équilibre : réduire les dérives commerciales sur des produits à risque, tout en ne bloquant pas l’information de santé légitime. Le virage vers une acceptation limitée d’usages « contextuels » de termes liés aux médicaments s’inscrit dans cette ligne. Pour l’écosystème numérique santé, la clé restera la traçabilité : qui parle, à qui, de quoi, et avec quelles sources ? Plus les messages seront sourcés, non promotionnels, et raccords au droit local, plus l’espace publicitaire s’ouvrira sans friction.
À court terme, la vigilance s’impose pour toutes les prochaines campagnes : revoir les créations et les landings, sécuriser les certifications, vérifier la liste des « restricted drug terms » et, pour les opérateurs présents au Royaume-Uni ou à Singapour, valider les nouvelles marges de manœuvre en télémédecine. À moyen terme, c’est la capacité à produire des contenus de santé utiles, lisibles et conformes, tout en mesurant finement la performance, qui fera la différence dans un paysage où la règle évolue désormais par touches successives.
Source : Google

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.