Modéliser un patient pour mieux soigner : les jumeaux numériques entrent en scène, entre accélération technologique et impératif de transparence, d’explicabilité et de bénéfice clinique démontré. Décryptage avec l’Agence du Numérique en Santé et la Délégation au numérique en santé.
Longtemps cantonné aux usines et aux avions, le concept de « jumeau numérique » fait irruption en santé avec une promesse séduisante : modéliser, en dynamique, un patient, un organe ou un processus physiologique pour simuler l’évolution d’une pathologie et anticiper l’effet d’un traitement. À la clé, une médecine plus personnalisée, plus prédictive, potentiellement plus précise.
Mais cette puissance de simulation impose d’emblée un cadrage éthique rigoureux : le jumeau n’est pas le patient, il en est une représentation calculée, utile si elle reste au service du jugement clinique et des droits des personnes. C’est l’axe central du décryptage publié le 2 octobre 2025 par la Délégation au numérique en santé, qui renvoie à une note de cadrage détaillant définitions, cas d’usage et lignes rouges.
Le document, élaboré par un groupe d’experts réunissant cliniciens, chercheurs, ingénieurs, juristes, philosophes, représentants de patients et industriels, clarifie d’abord les mots. En santé, le jumeau numérique est défini comme une représentation virtuelle dynamique de la physiologie et/ou de la pathologie d’un individu, nourrie de données multiples (cliniques, biologiques, génétiques, environnementales et comportementales) et mise à jour en continu. Le choix du terme « représentation » n’est pas anodin : il écarte l’illusion d’une « réplique » fidèle pour rappeler qu’un modèle reste une simplification paramétrée, dont la valeur dépend de l’usage, de la qualité des données et des hypothèses retenues.
Sur le plan clinique, les perspectives sont tangibles. Un jumeau peut servir d’aide à la décision, en testant virtuellement plusieurs options thérapeutiques avant d’intervenir, ou soutenir l’éducation thérapeutique en rendant visibles les effets attendus d’un traitement ou d’un changement de comportement. Des déclinaisons par organe (cœur, peau, appareil respiratoire) sont déjà envisagées pour affiner compatibilités et risques, par exemple en transplantation. À plus long terme, l’horizon du « patient entier » demeure un idéal de recherche qui appelle humilité et transparence.
Là où l’innovation bouscule le plus, c’est sur le terrain de l’éthique. Le risque premier est la réduction de la personne à ses données : confondre la projection du modèle avec la réalité vécue. À cela s’ajoute le poids de la prédiction, qui peut glisser du probable au déterminisme et fragiliser la capacité d’agir des patients comme des soignants. La relation de soin se reconfigure : de la dyade patient-médecin à une « quadrangulation » intégrant le jumeau et ses concepteurs, avec une redistribution des responsabilités et de la confiance. D’où des exigences accrues de consentement réellement éclairé, explicable et réversible, et d’explicabilité des modèles pour éviter que l’autorité technique ne supplante la délibération clinique.
La gouvernance devient alors la clef de voûte. Qui répond d’une erreur issue d’une simulation ? Comment auditer des algorithmes complexes ? Quelle justice d’accès pour éviter une médecine à deux vitesses, réservée aux plus connectés ? Le cadrage propose de traiter ces questions à la racine : clarifier l’imputabilité entre professionnels, concepteurs et exploitants ; rendre les modèles auditables et compréhensibles par les soignants comme par les usagers ; et aligner le développement sur les principes du Cadre de l’éthique du numérique en santé, sous l’égide du COMENS.
Une dimension souvent invisibilisée, mais décisive, est l’empreinte écologique. Les jumeaux numériques reposent sur des infrastructures lourdes, des volumes de données élevés et des calculs intensifs. La note appelle une « sobriété par conception » : minimisation des données collectées, mutualisation des infrastructures, optimisation énergétique des algorithmes et hiérarchisation des simulations selon leur utilité clinique, pour éviter que la médecine dite « durable » ne s’appuie sur des architectures énergivores.
La France s’inscrit dans une dynamique européenne structurante. Le programme EDITH coordonne, au niveau de l’UE, la communauté Virtual Human Twin et prépare référentiels et plateformes de simulation. Côté français, le projet MEDITWIN fédère IHU, CHU, Inria, start-ups et Dassault Systèmes pour industrialiser des « produits de santé virtuels » en neurologie, cardiologie et oncologie sur une plateforme souveraine, dans le cadre de France 2030. Ces chantiers posent l’équation : faire progresser la preuve clinique et l’industrialisation, sans sacrifier la transparence, l’équité et la soutenabilité.
Le cap, enfin, est posé sans ambiguïté : un jumeau numérique n’a de sens que comme allié réflexif du soin. Sa juste place se mesure à sa capacité à éclairer la décision, à renforcer l’autonomie des personnes et à améliorer des trajectoires réelles, pas à supplanter la relation et la prudence cliniques. La feuille de route proposée par la DNS (de la définition à la vigilance éthique, du consentement modulable à l’auditabilité, de la justice sociale à l’écoconception) trace une voie exigeante mais féconde : transformer une prouesse computationnelle en progrès médical partageable, explicable et soutenable.
Source : Agence du Numérique en Santé / Délégation au numérique en santé

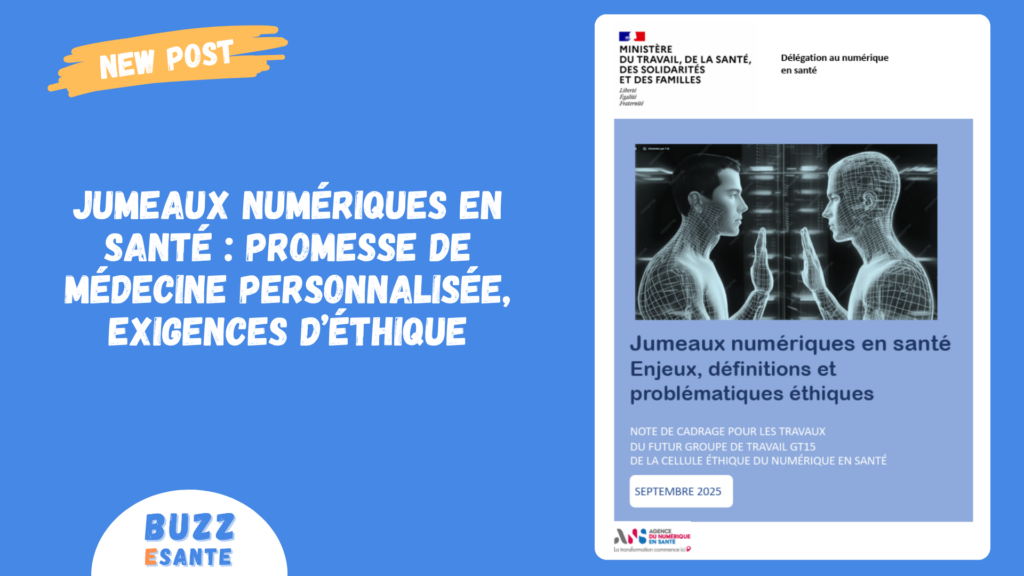
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.